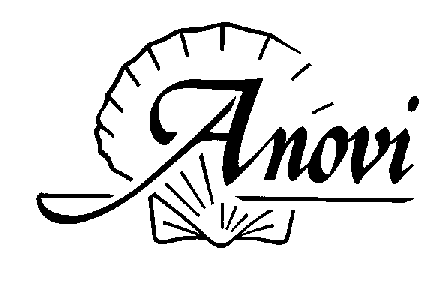|
|
Eylau
Leontii Leontievich Bennigsen[1]
 Le général
Bennigsen vient, le 3 janvier 1807,
d’être nommé commandant en chef de l’armée russe, lorsqu’il
décide de prendre l’offensive en Pologne. Il a laissé, dans ses Mémoires,
un récit de la bataille, qui tourne parfois à l’auto-satisfaction et prend des allures de justificatif.
Nous présentons ici ces pages, sans les commentaires, très documentés, du capitaine
Cazalas, auteur de la traduction française, ceci pour
laisser le lecteur porter lui-même son propre jugement.[2]
Le général
Bennigsen vient, le 3 janvier 1807,
d’être nommé commandant en chef de l’armée russe, lorsqu’il
décide de prendre l’offensive en Pologne. Il a laissé, dans ses Mémoires,
un récit de la bataille, qui tourne parfois à l’auto-satisfaction et prend des allures de justificatif.
Nous présentons ici ces pages, sans les commentaires, très documentés, du capitaine
Cazalas, auteur de la traduction française, ceci pour
laisser le lecteur porter lui-même son propre jugement.[2]
Les évènements meurtriers des
journées des 26 et 27 janvier/7 et 8 février, qui resteront mémorables dans les
annales de la guerre, demandent une explication toute particulière ; je
laisse au lecteur le soin de juger du degré d’importance qu’on peut
donner aux suites de ces deux journées.
Le 26 janvier (7 février) dans
la nuit, l’armée marcha sur deux colonnes, dans le même ordre de bataille
que la veille, de Landsberg à Preussisch-Eylau
(marche de 2 milles), la 1e colonne par Woymanns,
Zipperken, Gallehnen et Grünhöfchen ; la 2e colonne par Kumkein, Dultzen, Körnen et Storchnest. A mon
arrivée à Preussisch-Eylau, je fis prendre position de
l’autre côté de la ville, pour deux raisons : la première pour
m’assurer plus parfaitement, dans tous les cas, ma marche sur la Pregel
et sur Königsberg, qui renfermait, comme je l’ai déjà dit, beaucoup
d’articles nécessaire à l’armée ; et la seconde parce que le
terrain y était plus ouvert, ne pouvant être dominé d’aucun côté, et
assez convenable à l’action de la cavalerie. ; la
position présentait u reste peu d’avantages de terrain et les ailes
étaient sans appui assuré. Il n’y eut que le centre, commandé par le
lieutenant général Dokhtourov[3]
qui fut avantageusement placé, occupant des élévations propres à établir des
batteries vis-à-vis de la ville.
L’aile droite, commandée
par le lieutenant général Touchkov[4],
faisant un angle, s’appuyait au village de Schloditten et était couverte
à une certaine distance par un ruisseau marécageux ; quoiqu’il fût
gelé, il était pourtant assez difficile d’y faire passer de
l’artillerie ou de faire agir la cavalerie en masse.
L’aile gauche, commandée
par le lieutenant général comte Ostermann[5],
s’étendait jusqu’au village de Serpallen,
auquel elle s’appuyait. Le général major comte Kamensky[6],
avec la 14e division, fit la réserve de l’aile gauche ;
le général major Somov, avec 12 bataillons de la 11e division, la
réserve du centre, et le général major Markov, avec son détachement, qui se
trouvait à l’arrière-garde, fut destiné à faire la réserve de
l’aile droite.
L’ordre de bataille, que
j’avais introduit, fut le suivant : dans la 1e ligne,
chaque régiment mettait son 3e bataillon en réserve à 100 pas
derrière les deux premiers bataillons. Chaque régiment de la 2e
ligne formait une colonne par bataillons déployés. Dans cet ordre, les 3e
bataillons de la 1e ligne de réserve pouvaient porter du secours à
cette même ligne avec célérité, partout où la nécessité le demanderait, sans
rompre la ligne, ni causer de brèches, et deux ou trois régiments de la seconde
ligne pouvaient très facilement, et en peu de temps, se former en une seule
colonne, et se porter où on en aurait besoin.
J’ai trouvé dans toutes
les actions de l’avantage dans cet ordre de bataille contre le système de
ces grandes colonnes, que l’armée française a adoptées dans ses attaques
et contre lesquelles on ne peut résister qu’en se tenant dans un ordre
profond sur des positions défensives. Car comment une simple ligne, qui
n’a que trois rangs de profondeur, peut-elle résister et ne pas être
enfoncée par des colonnes dans lesquelles j’ai vu souvent dans les
attaques des Français 10.000 hommes et encore plus ? L’empereur
napoléon, ce grand capitaine, a si bien calculé l’avantage des fortes
colonnes dans ses attaques contre le système des lignes minces sur trois rangs
de profondeur, dont on n’a pas voulu revenir jusqu’ici, qu’il
a, avec facilité même, enfoncé, culbuté et battu complètement toutes les armées
auxquelles jusqu’à cette époque il avait livré bataille. Dans le premier
choc, ces grandes colonnes serrées doivent certainement perdre du monde par
l’artillerie ennemie ; mais dès qu’une ligne est enfoncée par
ces grandes masses, il n’y a plus de remède ; ces colonnes avancent
sans donner le temps à ces lignes rompues et dispersées de se reformer ;
rien ne peut les arrêter et une armée, une fois enfoncée de cette manière et
n’ayant pas de masses prêtes et en état d’arrêter des fortes
colonnes, sera toujours battue complètement. C’est aussi par ce système
de tactique que Napoléon, dans toutes les guerres précédentes, a battu si
complètement toutes les armées de ses adversaires à la première rencontre et
qu’une seule bataille suffisait pour les réduire à demander la paix avec
des sacrifices énormes, comme on peut en citer tant d’exemples. Je
conclus donc qu’il n’y a d’autre principe à adopter pour résister
aux attaques de ces grandes colonnes que d’agir en masse comme les
Français et d’avoir de fortes réserves toujours à portée. A
Preussich-Eylau, les deux armées se rencontrèrent et livrèrent bataille à peu
près sur les mêmes principes. L’armée russe ne fut enfoncée sur aucun
point, malgré les grosses colonnes qui l’attaquèrent avec acharnement, et
elle résista aux forces supérieures qui l’attaquèrent, comme vous le
verrez, Général, par le récit de cette journée.
Notre arrière-garde fut peu
poursuivie dans cette marche par l’ennemi. Quand elle s’approcha à
¾ de mille de Preussich-Eylau, j’envoyai faire savoir au prince Bagration[7]
qu’il était nécessaire d’arrêter autant que possible
l’ennemi, vu que la tête de notre grosse artillerie ne faisait que
toucher la ville de Preussich-Eylau. Je lui fis expédier en même temps un
renfort, composé des régiments de grenadiers de Moscou et de mousquetaires de
Sophie[8]
de la 8e division et, en cavalerie, les régiments de dragons de
Saint-Pétersbourg et d’Ingermanland.
Voyez le plan de cette
bataille. Je dois vous prévenir en même temps que tous les lacs que vous
trouverez sur ce plan étaient tellement gelés qu’ils ne mirent aucun
obstacle aux manœuvres et qu’il y eut même des charges de cavalerie
sur plusieurs d’entre eux.
En conséquence de cet ordre,
le prince Bagration fit indiquer au général Markov pour son détachement la
position entre les lacs de Tenknitten et de Warschkeiten ; le renfort qui arriva dans ce moment de
la 8e division fut placé au même endroit, un peu en arrière. Quand
on eut pris cette position, de fortes colonnes d’infanterie ennemie
(…)[9],
précédées de chasseurs à cheval, disposés en flanqueurs, furent reçues par le
feu tant de nos tirailleurs (…) que de nos batteries, qui cependant ne
purent arrêter leur marche. Alors le général Markov alla à la baïonnette
(…) avec les régiments de Pskov et de Sophie, contre la colonne ennemie,
qui fut renversée. L’autre colonne fut attaquée en même temps et culbutée
par le régiment de dragons de Saint-Pétersbourg, commandé par son brave colonel
Balk[10].
Cette colonne fut mise en déroute et perdit un drapeau. Une troisième colonne,
qui accourait au secours des deux premières, fut également arrêtée par les
batteries du colonel Ermolov[11].
Mais ces colonnes ne se retirèrent pas loin ; elles furent bientôt
rejointes par des renforts de leur armée en pleine marche, qui
s’approchaient à grand pas.
L’ennemi fit jouer de
grandes batteries (…) et renouvela l’attaque avec quatre colonnes
(…) Les grenadiers de Moscou, commandés par leur chef, le prince Charles
de Mecklembourg, et les tirailleurs du 24e régiment de chasseurs
entrèrent en action. Trois de ces colonnes ennemies dirigèrent leur marche
droite contre la position du prince Bagration et la quatrième menaça de tourner
son aile droite. Le général Bagration, s’apercevant que le détachement du
général Markov commençait à souffrir par suite de la supériorité en force de
l’ennemi, le fit retirer.
Comme alors toute
l’armée était déjà rangée et prête à rencontrer l’ennemi, craignant
qu’à la fin notre arrière-garde ne courut des pertes considérables, je
fis savoir au prince Bagration qu’il était nécessaire qu’il se
repliât sur Preussich-Eylau et qu'il fit entrer ses troupes dans la position de
notre armée, ce qu'il exécuta avec le plus grand ordre. Plusieurs régiments de
cavalerie française, qui voulurent profiter de cette retraite (...) furent
encore une fois lancés à l'attaque et repoussés avec pertes par les régiments
de cuirassiers de l’Empereur, le régiment de hussards d’Elisabetgrad et celui de dragons d’Ingermanland. Le colonel Ermolov
se distingua encore beaucoup à cette occasion : il sut si bien profiter du
terrain avec son artillerie volante et la fit jouer toujours si à propos, que
l'ennemi ne suivit notre arrière-garde qu’avec beaucoup de
circonspection. A l'arrivée du prince Bagration avec l’arrière-garde, le
général Barclay de Tolly[12]
fut désigné pour occuper et défendre la ville avec les
régiments de chasseurs de son détachement.
 Les troupes qui composaient
notre armée furent rangées en bataille dans l’ordre suivant : les 5e,
8e, 7e, 3e, 2e, 4e et 14e
divisions ; le général Baggowouth[13]
avec son détachement ; la cavalerie sur les deux ailes.
Les troupes qui composaient
notre armée furent rangées en bataille dans l’ordre suivant : les 5e,
8e, 7e, 3e, 2e, 4e et 14e
divisions ; le général Baggowouth[13]
avec son détachement ; la cavalerie sur les deux ailes.
A 4 heures passées,
l’armée française parut en face de notre position du côté opposé à la
ville et commença à se mettre en bataille, mais encore hors de la portée du
canon. Un corps français, cependant, s’approcha et attaqua si vivement la
ville que le général Barclay, se voyant serré de tous les côtés, fut obligé de
céder et se borna à s’établir dans les jardins qui touchaient à la ville
du côté de notre position. Mais comme je désirais que l’ennemi ne parvint
pas à se loger pendant le jour entre la ville et notre position, ce qui aurait
pu fatiguer inutilement mes troupes par des alarmes continuelles pendant la nuit,
je fis partir le général Somov avec neuf bataillons de la réserve, avec ordre
de reprendre la ville ; le même ordre fut aussi donné au général Barclay.
Le général major Somov attaqua
la ville du côté du cimetière sur trois colonnes (…) ; la colonne de
gauche (…) fut arrêtée un moment par l’ennemi, mais les deux autres
colonnes (…) pénétrèrent dans la ville ; elles se firent jour à la
baïonnette et le général Somov parvint à se joindre avec ses neufs bataillons
au détachement du général Barclay qui, en attendant, avait pénétré de même
jusqu’à la grande place de la ville. Ces deux généraux en délogèrent
entièrement l’ennemi, à son tour, avec une perte assez considérable en
tués, blessés et prisonniers.
Le général Barclay eut le
malheur d’être blessé grièvement au bras par une balle, qui lui fracassa
l’os. Ce bon et brave général fut obligé de quitter le champ de bataille
et de se faire transporter à Königsberg, au grand regret de toute
l’armée, pour se faire soigner.
Je fis insinuer au général
Somov, qui avait pris le commandement de toutes les troupes qui se trouvaient
dans la ville après le départ du général Barclay, de s’y maintenir
jusqu’à nouvel ordre. Une nuit très obscure, qui survint, mit fin aux
combats de cette journée, qui coûta déjà à l’ennemi considérablement de
monde, dont plus de 500 prisonniers qui tombèrent dans nos mains.
Après 10 heures du soir,
j’envoyai un officier au général Somov avec un ordre d’évacuer la
ville le plus tranquillement possible, pour ne pas donner l’alarme à
l’armée française, de former ses 12 bataillons avec le régiment d’Arkhangelgorod entre la ville et notre première ligne, de
s’y établir et d’y rester pendant la nuit ; ce qu’il
exécuta parfaitement après 11 heures u soir.
Deux bataillons de grenadiers
de Moscou furent placés dans la même intention à Serpallen.
Je dois vous expliquer,
Général, quelles furent mes intentions en évacuant la ville de Preussich-Eylau,
qui se trouvait pourtant si près de notre front, et dont l’occupation
aurait pu garantir notre centre de toute attaque. Mais rappelez-vous que
j’ai déjà dit, au commencement de cette lettre, qu’il n’y
avait dans notre position que le centre d’avantageusement placé. Ne
devais-je donc pas tâcher d’y attirer l’ennemi, ayant encore tout
le temps de m’y préparer, et de profiter de l’avantage que le
terrain m’offrait pour y recevoir celui-ci ? Vous jugerez,
d’après la relation de cette bataille, ce qui aurait pu nous arriver si
l’ennemi, au lieu de s’opiniâtrer à vouloir enfoncer notre centre,
s’était contenté d’y faire des démonstrations, et s’il avait
employé sur notre aile gauche toutes les forces qu’il perdit inutilement
sur ce point.
Mon quartier général fut
établi ce jour là à Auklappen. Quand j’y reçus le
rapport que le général Somov avait évacué la ville, je fis expédier
l’ordre suivant aux généraux de division :
« Le général Dokhtourov
sortira incessamment du centre avec la 7e division forte de 14
bataillons, et cette division, en y joignant 12 bataillons, formera la réserve
du centre, vis-à-vis de la ville. Le
général Dokhtourov, qui commandera cette réserve, en
formera deux colonnes par bataillons déployés. Le lieutenant général commandant
l’aile droite, appuiera à gauche, pour remplir, avec ses troupes et la
réserve du général Markov, l’intervalle qu’occupait la 7e
division dans la première ligne ; il laissera un gros détachement dans le
village de Schloditten ; des cosaques et quelque cavalerie de l’aile
droite occuperont la plaine dans ce village. Ce changement dans notre position
doit s’exécuter sans perte de
temps, et aussitôt que les généraux auront reçu cet ordre. »
La 14e division,
aux ordres du général-major contre Kamensky, resta en réserve à l’aile
gauche.
Deux régiments de chasseurs du
détachement du général Barclay se dispersèrent en tirailleurs devant le centre
de notre position ; le reste des troupes de ce détachement se réunit à
celui de Baggowouth à l’aile gauche.
L’armée française resta pendant
la nuit dans la position qu’elle avait occupée durant la journée.
Le 27 janvier/8 février, entre
4 et 5 heures du matin, je me rendis devant le front de notre position,
vis-à-vis de la ville, qui par le changement que j’avais fait faire dans
notre répartition se trouvait alors plus rapprochée de notre aile droite. Les
feux que l’ennemi avait allumés me firent bientôt apercevoir
qu’effectivement un corps français assez considérable avait déjà passé
par la ville de Preussich-Eylau. Je fis alors retourner la réserve du général Samov et les deux bataillons de grenadiers de Moscou à
leurs places et je fis encore avant le jour avancer nos batteries de position
sur des hauteurs déjà choisies la veille, vis-à-vis de la ville.
A la pointe du jour, des tirailleurs
et des chasseurs à cheval ennemis avancèrent ; un feu très vif
s’engagea alors entre eux et nos deux régiments de chasseurs dispersés en
tirailleurs. Dès qu’il fit assez jour pour pouvoir distinguer les
colonnes ennemies, qui se mirent en mouvement entre notre position et la ville,
et celles qui en débouchaient, j’envoyai à l’artillerie de
position, qui se trouvait en batterie vis-à-vis de la ville, l’ordre de
commencer son feu pour éviter principalement que l’ennemi ne pût d’abord
reconnaître le changement de position exécuté par nous durant la nuit. La
batterie du colonel comte Sievers[14]
tira d’abord avec le plus grand succès. On distingua alors la formation
d’épaisses colonnes ennemies assez loin, entre la ville et
l’élévation voisine de la ville. Peu après, nos batteries de position
ouvrirent leur feu tant sur ces colonnes que sur celles d’infanterie
(…) et de cavalerie, qui sortaient de la ville, et se portaient sur notre
aille droite, commandée par le lieutenant général Toutchkhov.
L’ennemi, qui se vit arrêter de ce côté d’abord à la première
charge, occupa les bâtiments dits Stadt-Mühle qui se
trouvaient devant cette aille, pour déboucher de là ; mais il y fut
repoussé par le 24e régiment de chasseurs et des tirailleurs.
L’ennemi fit renforcer, en attendant, ses troupes de ce côté ;
plusieurs colonnes d’infanterie et de cavalerie sortirent de nouveau de
la ville pour attaquer notre aile droite, sur quoi le général Toutchkhov ordonna au major général Foch[15]
d’avancer avec sa brigade d’infanterie, soutenue par les deux
régiments de dragons de Riga et de Livonie. Le général Foch attaqua ces
colonnes très vigoureusement à la baïonnette, les mit en déroute et les
détruisit en partie.
Trois colonnes ennemies, parmi
lesquelles se trouvaient les Gardes impériales, s’avancèrent bientôt
contre notre centre. Le général Dokhtourov envoya à
leur rencontre le général Zapolsky[16]
avec la colonne (…) de la réserve ; elle se déploya, les deux fronts
s’approchèrent de très près avec un feu continuel. Dès que le général Zapolsky
s’aperçut que l’ennemi s’arrêtait, il le chargea à la
baïonnette, le fit plier et le poursuivit jusqu’en (…) ; cette
colonne ennemie perdit beaucoup de monde en tués et blessés, elle perdit en
outre une aigle et 130 prisonniers. En même temps, une partie de la colonne
ennemie (…), soutenue par une autre colonne (…) arriva encore près
de la première ligne de notre centre. Nos régiments les plus près la
rencontrèrent baïonnette baissée et la mirent en déroute. Quelques régiments,
qui se trouvaient en réserve derrière le centre, profitèrent du moment, et
achevèrent la plus grande partie de ces colonnes. Quelques escadrons de
cuirassiers ennemis appartenant au corps des gardes avaient réussi à passer par
un intervalle entre deux régiments d’infanterie de notre première ligne
et à pénétrer entre celle-ci et la seconde ligne ; mais malgré toute la
bravoure avec laquelle ils se défendirent et tous les efforts qu’ils
firent, ils ne purent jamais en ressortir. On leur cria à différentes reprises de
se rendre ; mais ils continuèrent à faire des efforts dans l’espoir
de se faire jour et de retraverser la 1e ligne, ce qui leur coûta à
la fin la vie à presque tous. Le capitaine Maret entre autres fut blessé
d’un coup de lance par un cosaque qui le jeta à bas de son cheval. Malgré
les soins que je fis prendre de lui, il mourut de sa blessure quelques jours
après à Königsberg.
Tandis que ces évènements se
passaient, une autre colonne ennemie fut repoussée dans ce même moment avec
pertes par les régiments de grenadiers de Moscou et de mousquetaires de Schlüsselbourg, commandées par le prince Charles de
Mecklembourg. Toutes ces troupes repoussées se réunirent dans leur retraite.
Elles furent encore renforcées par des troupes fraîches et deux colonnes de
cavalerie. Alors, ils retournèrent à la charge. Dès que le général Dokhtourov s’en aperçut, il fit partir le général
Somov avec toute la colonne (…) qui se déploya en bataille. Nos régiments
de cavalerie, qui s’étaient trouvés jusqu’à ce moment en réserve
derrière le centre, se formèrent en (…) et le général Zapolsky attaqua
une seconde fois conjointement avec la cavalerie ces colonnes ennemies, dont
celle de cavalerie, placée á leur gauche, fut repoussée par le colonel comte Orourck[17],
qui se jeta sur elle avec trois escadrons, l’enfonça et la poursuivit
jusqu’aux batteries ennemies. Celles d’infanteries furent encore
repoussées avec pertes et poursuivies jusqu’à leur ligne.
Dans chacune de ces charges,
on prit plus ou moins de prisonniers.
Dès la pointe du jour, des colonnes
ennemies avaient attaqué à notre aile gauche, avec de l’infanterie
légère, le détachement du général Baggowouth, placé devant le village de Serpallen ; on envoya d’abord des tirailleurs
contre des colonnes. Le général Kakhovsky[18]
avec le régiment de hulans polonais[19]
et les cuirassiers de la Petite-Russie, se trouvant à
gauche de Serpallen (…) repassa le village et
attaqua la colonne d’infanterie ennemie (…), la culbuta et la fit
plier vers Eylau ; le reste de cette colonne se retira dans le bois.
Le général Kakhovsky reçut
alors l’ordre de se rendre avec ses régiments de cavalerie à notre
droite, où il attaqua encore les colonnes ennemies (…) et les contraignit
à se retirer de même.
Le général comte Pahlen[20],
commandant la cavalerie de l’aile droite, ordonna au général-major baron Korff[21]
d’attaquer avec sa brigade les colonnes ennemies, qui se trouvaient
vis-à-vis la division du général Sacken ; ici,
l’ennemi fut entièrement culbuté. Nos cuirassiers de Saint-Georges
prirent une aigle et firent plus de 100 hommes prisonniers.
Les régiments de hussards
d’Izioum et de dragons de Courlande firent
encore avec succès plusieurs charges sur notre droite, et repoussèrent
l’ennemi avec pertes.
Les colonnes ennemies, qui serraient
de près le général Baggowouth, munies d’une forte artillerie en position
sur les Kreege berge obligèrent ce général à se
retirer, d’autant plus que les autres colonnes commençaient à tourner sa
gauche. En conséquence de ce mouvement, le général Baggowouth se place au sud
d’Auklappen, sur la gauche de la division du
général comte Ostermann contre laquelle l’ennemi avança avec rapidité. Un
feu très vif s’engagea d’abord entre les tirailleurs des deux
côtés.
Le comte Ostermann prit alors
le parti d’envoyer en avant les 3e bataillons de chaque
régiment de la première ligne de sa division, les fit soutenir par sa réserve
et fit attaquer ces colonnes ennemies. Après un combat opiniâtre et sanglant,
l’ennemi fut aussi repoussé sur ce point. Mais bientôt après on vit le
mouvement de fortes colonnes ennemies (…) qui avançaient sur notre gauche
pour tourner cette aile. Alors le comte Ostermann, pour la refuser, cru de son
devoir de changer complètement sa position premièrement en (…), et de là encore
plus loin (…) ; il s’y trouvait d’autant plus engagé que
le comte Kamensky avait déjà été obligé de prendre avec sa réserve une position
(au nord d’Auklappen), pour couvrir notre
gauche.
Dès que je m’aperçus de
ce mouvement de notre aile gauche, et de la direction que le corps du maréchal
Davout avait prise pour la tourner (par Kutschitten),
j’ordonnai un changement dans nitre position. Le général Steinheil[22],
chef de mon état-major, qui était allé pour faire exécuter ce mouvement, fit
avancer notre artillerie volante, dont il fit placer trois batteries (près
d’Auklappen) ; celles-ci ouvrirent une
canonnade avec beaucoup de succès ; non seulement elles arrêtèrent la
marche des colonnes ennemies, mais elles en firent même replier une qui, en se
retirant, mit le feu à la ferme d’Auklappen.
L’ennemi, après avoir
forcé le général comte Kamensky à se replier jusqu’en (…), occupa
le village de Kutschitten, mais en fut bientôt délogé
par le détachement du général Tchaplitz[23],
composé de trois escadrons du régiment de hussards de Pavlograd,
du régiment d’infanterie de Moscou et d’une partie des cosaques. Ce
détachement passa par Kutschitten, attaqua la colonne
ennemie (…)) et la fit plier.
 L’ataman du Don
et le lieutenant–général Platov[24]n’arriva
à l’armée que le 26 janvier/7 février dans
un moment où
les troupes se trouvaient déjà en position
derrière Preussich-Eylau et où les
différents corps et détachements étaient
déjà distribués aux généraux, ce qui
m’empêcha de lui donner un commandement conforme à
son rang et à ses capacités.
Il prit donc, en attendant, celui des régiments de cosaques qui
se trouvaient
présents, et dont la force ne monta qu’à 2.500
hommes. Ce général
n’en fut pas moins actif dans cette affaire, avec sa petite
troupe.
L’ataman du Don
et le lieutenant–général Platov[24]n’arriva
à l’armée que le 26 janvier/7 février dans
un moment où
les troupes se trouvaient déjà en position
derrière Preussich-Eylau et où les
différents corps et détachements étaient
déjà distribués aux généraux, ce qui
m’empêcha de lui donner un commandement conforme à
son rang et à ses capacités.
Il prit donc, en attendant, celui des régiments de cosaques qui
se trouvaient
présents, et dont la force ne monta qu’à 2.500
hommes. Ce général
n’en fut pas moins actif dans cette affaire, avec sa petite
troupe.
Il envoya deux régiments,
celui de Sissoiev[25]
et celui de Malachov, à notre aile droite ; il
mit à portée du centre les régiments d’Andronov
et de Kissélev et se rendit lui-même à notre aile
gauche avec quatre régiments, savoir, ceux d’Ilovaisky
IX[26],
de Grékov XII, d’Éfremov
III[27]
et de Papouzine. Nos cosaques de l’aile droite
empêchèrent à différentes reprises des partis de cavalerie ennemie de passer
les marais devant le village de Schloditten. Ceux du cente
contribuèrent beaucoup à la défaite des cuirassiers français, qui avaient percé
entre notre 1e et notre 2e ligne. Le régiment de Kissélev s’y distingua particulièrement et fit
prisonnier un officier et 20 cavaliers, les seuls de cette cavalerie qui
échappèrent à la mort. Les régiments cosaques prirent part à toutes les charges
qui eurent lieu et dans lesquelles ils firent 450 hommes prisonniers.
Vous verrez, Général, sur le
plan de cette bataille, combien de terrain nous avions déjà perdu par le
troisième changement de front de notre aille gauche, tandis que notre aile
droite avait constamment conservé sa première position. La prudence avait
commandé que nous refusions peu à notre aile gauche contre les forces
supérieures de l’ennemi, qui manoeuvrait pour la tourner.
Mais, vers le soir, arriva le lieutenant-général L’Estocq,
avec le corps prussien, dans lequel se trouvait aussi un régiment
d’infanterie russe, celui de Viborg, et deux régiments de cosaques, sur
le chemin de Drangsitten et d’Althof, suivi de
très près par le maréchal Ney avec son corps.
Nous avions laissé le général
L’Estocq à Wuhsen. Après qu’il eut passé
avec son corps par Langwiese, Engelswalde,
Schönfeld, Tiefensee, Montitten, Rositten et Wackern, il rencontra la tête du corps du maréchal Ney. Il
fit occuper ce dernier endroit par les détachements des généraux Plötz et Prittwitz, qui
arrêtèrent l’ennemi, tandis que lui-même, avec le corps principal, passa
par Pompicken et arriva dans l’après-midi à
Althof. Les détachements des généraux Plötz et Prittwitz ne purent plus suivre le général
L’Estocq ; ils furent obligé de céder, à la fin, à la supériorité de
l’ennemi et de se replier sur Kreuzburg, sur le
chemin de Königsberg, ce qui procura un double avantage. D’abord celui
que cette ville fut couverte sur ce grand chemin, et ensuite que
l’ennemi, qui prit ces détachements pour tout le corps prussien, ne mit
plus d’obstacle à sa marche sur Althof. Les forces que nous amena le
général ne montaient pas au-delà de 6.000 hommes sous les armes, y compris le
régiment russe de Viborg et à peu près 400 cosaques, qui se trouvaient dans ce
corps. Le général L’Estocq avait laissé une petite arrière-garde en
chemin, qui tiraillait avec l’avant-garde du maréchal Ney, pour arrêter
autant que possible sa marche. Le lieutenant-général L’Estocq passa
d’Althof, entre Schloditten et Schmoditten, et
se porta sur notre aile gauche, position que je lui avais fait assigner
d’avance, et où nous avions le plus besoin de ce renfort, qui nous fut
très utile, mais qui toutefois était encore bien loin de rendre nos forces
égales avec celles que l’ennemi y avaient portées.
Le général L’Estocq, dès
son arrivée sur notre aile gauche, fit attaquer le village de Kutschitten, que l’ennemi avait déjà occupé et dont
il fut délogé avec une perte de quatre canons. L’ennemi fut délogé
ensuite d’une hauteur derrière Kutschitten.
Dans ces attaques se distinguèrent principalement le régiment
d’infanterie russe de Viborg sous les ordres du colonel Pillar[28],
les régiments d’infanterie prussiens Schöning
et Rüchel, et le bataillon de grenadiers Fabecky.
Le général comte Kamensky
avança de même et se plaça avec sa réserve et le détachement du général Tchplitz (près d’Auklappen).
Le général L’Estocq fit jouer son artillerie de position contre les
colonnes ennemies placées dans un forêt (le Birken Wälden) ; il envoya des tirailleurs contre ceux de
l’ennemi (…) qu’ils délogèrent ; il se porta ensuite,
conjointement avec le général comte Kamensky, en avant (vers Sausgarten) et ces
généraux forcèrent les colonnes ennemies, qui avaient déjà tourné notre aile
gauche à se retirer. La nuit, devenant trop obscure, arrêta les combattants
dans leurs attaques.
Tandis que ceci se passait, la
8e division, aux ordres du général Essen III[29],
et le détachement du général Markov, furent envoyés à l’aile gauche de la
2e division (…) Leurs chasseurs et ceux de la 3e
division firent une attaque vers Sausgarten pour soutenir celle du général
L’Estocq et du général comte Kamensky.
Le lieutenant-général Dokhtourov ayant reçu une contusion qui le força à quitter
le champ de bataille, son corps, composé des 7e et 8e
divisions, passa sous les ordres du lieutenant-général prince Bagration ;
ces deux divisions prirent position près de Schloditten.
La 5e division qui
faisait notre aile droite à Schloditten, soutenue par une batterie prussienne
placée par le général Fock en avant du village,
repoussa les dernières tentatives de l’ennemi contre cette aile.
Voyant que nos troupes
rentraient dans leur première position, je fis ordonner aux régiments de la 3e
division, le jour déjà baissé, de déloger encore l’ennemi du village de Klein-Sausgarten, qu’il avait occupé et qu’il
abandonna après un feu vif, mais court. Un temps couvert rendit alors la nuit
très noire.
Cette bataille, une des plus
sanglantes de notre temps, avait commencé le 26 janvier/7 février, à 3 heures
de l’après-midi, et fini le 27/8, à 7 heures du soir. Pendant quinze
heures de jour, dans ces deux journées, on s’était battu avec
acharnement. Des colonnes ou, pour mieux dire, des masses, après avoir été
exposées à tous les feux que l’artillerie fait jouer dans une action, se
rencontrèrent encore à l’arme blanche. Combien de charges de cavalerie se
sont réitérées dans ce combat ! Aussi les pertes que les deux armées y ont
faites sont énormes.
La nôtre fut de 9.000 hommes
de tués et 7.000 hommes de blessés ; dans ce nombre 700 officiers et 9
généraux de blessés.
Notre perte étant aussi
grande, chaque militaire pourra facilement juger quelle doit avoir été celle de
l’armée française et combien elle doit avoir perdu par ses attaques en
colonnes, qui furent repoussées partout et sur tous les points. Il est connu
que le corps du maréchal Augereau, après avoir passé par la ville, fit la
première attaque contre notre centre ; il fut en partie détruit, et les
débris de ce corps, après dette journée, furent répartis dans quelques autres
corps, surtout dans le 1er corps du prince de Ponte-Corvo. Nous
avions pris en outre cinq aigles et à peu prés 2000 prisonniers, dans le nombre
desquels il y eut quelques centaines de blessés. La perte de l’armée
n’a jamais été publiée, c’est-à-dire la véritable, mais on assure
généralement, et beaucoup de personnes qui peuvent en être instruites le
confirment, qu’elle dépassait 30.000 hommes, ce qui est très croyable à
en juger par la quantité de généraux et officiers de tout rang qui furent tués
et blessés ; 16 généraux entre autres, dans le nombre desquels se trouvait
aussi le maréchal Augereau blessé.
[1] Mémoires du général Bennigsen. Paris.
[2] Les références biographiques sont tirées de
l’indispensable „The Russian
Officer Corps in the Revolutionary and Napoleonic Wars“ de
Alexander Mikaberidce (2005)
[3] Dmitry Sergeyevich Dokhturov (1759
– 1816), commandant la 7e division russe. Il sera blessé à la
jambe gauche, durant la bataille
[4] Nikolay Alekseyevich Tuchkov (Tuchkov I) ( 1765 – 1812)
[5] Alexander Ivanovich Osterman-Tolstoy (1771
– 1857)
[6] Mikhail Mikhailovich Kamenski (Kamensky) (1777
– 1811)
[7] Peter Ivanovich
Bagration (1765 – 1812)
[8] Lire Sofia, petite ville près de Tsarskoié-Sélo
[9] Ici Bennigsen indique, par des lettres sur des
plans, les emplacements concernés. Mais ces plans ayant disparus, il n’a
pas été possible de les indiquer clairement.
[10] Mikhail Dmitryevicg Balk (1764 –
1818)
[11] Aleksey Petrovich Ermolov (Yermolov) (1772 – 1861)
[12] Mikhail Bogdanovich
Barclay de Tolly (1757 – 1818)
[13] Karl Fedorovich Baggovut (1761 – 1812)
[14] Yakov Karlovich Sievers (1774 – 1810),
artilleur.
[15] Alexander Borisovich Foch (1763 – 1825)
[16] Andrey Vasilievich Zapolsky (1768 –
1813)
[17] Joseph Kornilovich
O’Rourke (O’Rourke I) (1762 – 1849)
[18] Peter Demyanovich
Kakhovsky (1769 – 1831)
[19] Dans son rapport, Bennigsen parle du régiment de
hulans de Lituanie.
[20] Peter Pettrovich Pahlen (Pahlen III) (1778 – 1864)
[21] Fedor Karlovich Korf (1773 –
1823). Il sera blessé á la main gauche.
[22] Faddey Fedorovich Steingell (1762 – 1831). Il
a été nommé chef d’état-major de Bennugsen en
septembre 1806.
[23] Yefim Ignatievich Chaplits (1768 – 1825)
[24] Matvei Ivanovich Platov (1753 – 1818)
[25] Vasily Alekseyevich Sisoev (1772 – 1839)
[26] Gregory Dmitryevich Ilovaysky (Ilovaysky IX) (1778
– 1847). Il sera
blessé.
[27] Ivan Grigorievich Efremov (1773 - ?). Il sera blessé à la jambe gauche.
[28] Yegor Maksimovich Pillar (1767 – 1830)
[29] Peter Kirillovich Essen (Essen III) (1772 – 1844)