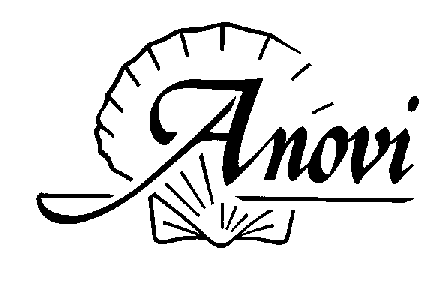

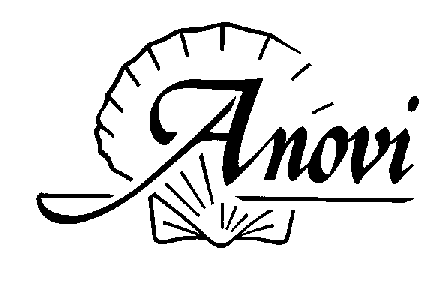 |
|
2 décembre 1805
La bataille d'Austerlitz
|
20
novembre 1805 La
Première de Fidelio à Vienne « De
tous mes enfants, c’est celui qui m’a causé
les pires douleurs.
|
A la fin de l’année 1802, après la
grave crise physique et morale qu’il vient de traverser (le
Testament d’Heiligenstadt est daté du 6 octobre 1802),
Beethoven a pris la résolution de vivre pour son art.
Et justement, le directeur du Theater an
der Wien lui propose d’écrire un opéra. Ce directeur, ce
n’est autre que le librettiste de la Flûte Enchantée, de
Mozart, et premier Papageno, le célèbre Emmanuel (en réalité
Johann Joseph) Schikaneder, que le succès de l’opéra de
Mozart a rendu riche et qui devine peut-être que Beethoven est
capable de rivaliser avec les Cherubini, Paer, Paisiello et autre
Cimarosa, que les théâtres concurrents offrent tous les jours
à leurs spectateurs. Très certainement, il espère aussi
réalisée avec Beethoven une opération aussi fructueuse
qu’avec Mozart.
A Vienne, à cette époque, les
théâtres ne manquent pas. Les décades précédentes, en plus
des Hof et Burg-Theater, quatre salles ont vu le jour dans les
faubourgs de Vienne : celui de Josefstadt, en 1776, celui de Leopolstadt,
en 1781 (on joue des parodies, des arlequinades et les aventures
comiques des Kasperl, des Staberl, et autres Thaderl. Les
Viennois lui donnent le surnom de Kasperltheater), celui de Wieden(où
la Flûte enchantée a été créée), celui de Landstrasse, en
1790, et, surtout, donc, le 13 juin 1801, le Theater an der Wien,
construit entre 1797 et 1801, par les architectes Josef Reymund
et Anton Jäger, et qui est alors le plus moderne de la
monarchie, devenant rapidement, et au moins pour un temps, le
rival de l’opéra de la Cour.
Le contrat, comme il est alors habituel,
prévoit que le compositeur recevra 10% des entrées pour les dix
premières représentations, ainsi qu’un logement gratuit.
Schikaneder propose donc à Beethoven de venir loger dans un des
bâtiments appartenant au complexe formé par le théâtre (de
nos jours, il n’est plus possible de situer où), où il lui
offre ce que l’on appellerait aujourd’hui un
appartement de fonction, que le musicien va néanmoins partager
avec son neveu, et souffre douleur, Karl, qui joue alors un peu
le rôle d’homme à tout faire du musicien. Celui-ci écrit
le 12 février 1803, à l’éditeur Härtel de Leipzig :
« Vous devez déjà savoir que mon
Frère est engagé par le Wiedner Theater ; il écrit un
opéra, il a l’orchestre sous lui, peut diriger quand cela
est nécessaire, car un directeur est là tous les jours »
Beethoven, qui emménage en mars
(peut-être janvier) 1803, n’est pas vraiment satisfait de
ce logement, car il donne sur une cour d’environ 2.50
mètres. En fait, il ne l’utilise que pour recevoir des
visites (l’annuaire des adresses de Vienne de la capitale
donne, pour 1805, cette adresse sous son nom), mais conserve
l’autre appartement qu’il a, la Pasqualatischen Hause,
sur la Bastei, où il s’enferme pour travailler, donnant à
son serviteur l’ordre d’empêcher quiconque d’y
pénétrer.
Par de nombreuses lettres de contemporains, il est possible de se faire une idée de l’apparence de cet appartement : parcimonieusement meublé, en désordre et parfaitement inconfortable. Le futur chef d’orchestre de la Première, Ignaz Seyfried, en a laissé une description intéressante particulièrement détaillée :
Ce premier séjour au théâtre ne va cependant pas durer
longtemps et le premier essai d’opéra, qui devait
s’intituler Vestas Feueret être présenté en mars 1804,
passe aux oubliettes (il en existe encore 81 pages autographes,
couvrant la première scène).
 En février 1804, Schikaneder, dont les
finances sont au plus bas, doit laisser la main et le théâtre
passe sous le contrôle du nouveau directeur général des
théâtres de la Cour, le comte Braun, que Beethoven connaît
bien, puisque qu’il a dédicacé trois de ses œuvres
(deux sonates pour piano et une pour cor) à son épouse,
excellente musicienne au demeurant.
En février 1804, Schikaneder, dont les
finances sont au plus bas, doit laisser la main et le théâtre
passe sous le contrôle du nouveau directeur général des
théâtres de la Cour, le comte Braun, que Beethoven connaît
bien, puisque qu’il a dédicacé trois de ses œuvres
(deux sonates pour piano et une pour cor) à son épouse,
excellente musicienne au demeurant.
Pour un temps, Beethoven doit donc
quitter son appartement de fonction.
Braun nomme à la tête du Theater an der
Wien, Joseph Sonnleithner, oncle du célèbre Grillparzer. Né à
Vienne dans une famille de musiciens réputés, Sonnleithner est
un ardent défenseur des arts. Il est alors secrétaire des
théâtres à la Cour, poste qu’il conservera jusqu’en
1814. Lui et Beethoven sont en relations depuis 1802.
Il s’empresse de commander
aussitôt, lui aussi, un opéra à Beethoven. Et ce dernier
retrouve son logement au théâtre.
D’un commun accord, un livret est
choisi : ce sera Leonore, où l’amour conjugal, du
Français Jean-François Bouilly.
Qui donc encore connaît ce dernier ? Né 1763 dans une petite ville française, La Couldraye, à proximité de Tours, Jean-NicolasBouilly avait étudié le droit, obtenant sa licence en 1787. La Révolution venue, il était retourné exercer son métier, tout en écrivant des pièces de théâtre à ses heures perdues. Durant la Terreur, il présida la Commission militaire, fonctions qui l’amènent à avoir connaissance des évènements, que l’on dit véritables, constituant notamment sa pièce intitulée Léonore, ou L'Amour Conjugal, assez mauvais mélodrame, écrit dans un style filandreux, et que Pierre Gaveaux a mis en musique, pour une première représentation à l’Opéra Comique de Paris, le 19 février 1798.
La pièce – classée dans le genre « tragédie
bourgeoise », mis à la mode à la fin du siècle
précédent par Diderot - raconte l’histoire d’une
Tourangelle qui, durant la Révolution, et sous un déguisement
masculin, délivre son mari de prison. L’histoire est
cependant prudemment transportée en Espagne. Elle avait eu un
succès retentissant en France, mais aussi en Allemagne. On en
avait tiré deux livrets, l’un en français, l’autre en
italien. Cette dernière version, mise en musique par Paer, sera
présentée pour la première fois le 3 octobre 1804.
Sonnleithner entreprend aussitôt la
traduction et l’adaptation du texte de Bouilly,
s’efforçant d’accroître les opportunités de
développements musicaux, en rallongeant la pièce originale,
pour présenter au musicien un livret en trois actes.
Le sujet enchante Beethoven (on trouvera
plus tard, parmi ses livres, un exemplaire de la partition de
Gaveaux), qui est attiré par les thèmes de la liberté, de
l’amour conjugal et de la fidélité (il se débat
d’ailleurs au même moment dans une affaire sentimentale
avec Joséphine von Brunswick, l’une des possibles
Immortelle Bien-Aimée, qui pourrait faire l’objet
d’une autre conférence), qui lui rappellent les grands
idéaux de la Révolution, qui l’ont fasciné durant sa
jeunesse.
Tous ceux qui l’ont approché, d’ailleurs, purent constater la rigueur et l’intransigeance de ses idées sur la pureté de l’amour, sur la sainteté du mariage. Alors, cette glorification de l’amour conjugal, du dévouement et de la fidélité jusqu’à la mort, ne pouvait que l’attirer.
Beethoven ne laisse pas les choses traîner et entreprend, dès
la seconde moitié de 1803, les travaux préparatoires pour son
opéra. S’il y travaille toute l’année suivante, 1804
est cependant marquée par l’achèvement de sa Troisième
Symphonie, la célèbre Heroica, à laquelle le nom de Bonaparte
restera attaché, et qui sera jouée en privé, pour la première
fois en août, au palais Lobkowitz. Au début du printemps 1805,
l’œuvre est largement esquissée, comme en témoignent
les célèbres Carnets d’Esquisses, où le musicien notait
ses idées, et qui forment un volume de pas moins de 346
pages !
L’été suivant, Beethoven est à Hetzendorf,
où il achève la composition de son opéra, souvent sous un
tilleul du parc de Schönbrunn, nous dit la légende.
L’espèce de frénésie avec laquelle il a travaillé, peut,
pour certains, s’expliquer par sa volonté d’éclipser
Cherubini, qu’il a rencontré pour la première fois au mois
de juillet, d’une façon plus ou moins amicale (les sources
varient à ce sujet)
Quoi qu’il en soit, en septembre, son opéra sous le bras, Beethoven retrouve son appartement au théâtre, et les répétitions commencent aussitôt.
Elles sont dirigées par Ignaz von Seyfried, un Bavarois né en
1776, dont Beethoven fait donc la connaissance au début de 1803.
Il est attaché comme chef d’orchestre au théâtre an der
Wien depuis l’âge de 21 ans et il se souviendra plus tard
qu’il « dirigeait l’étude des différentes parties
avec tous les chanteurs, suivant ses suggestions, ainsi que
toutes les répétitions d’orchestre. »
Seyfried a suffisamment le sens de l’humour pour supporter les sautes d’humeur du compositeur. Comme ce jour où le troisième basson est absent à une répétition, ce qui met Beethoven hors de lui, d’autant que le prince Lobkowitz
, présent, essaye de le consoler, en lui
disant que, les deux autres bassons étant présents, on ne
s’en apercevra pas ! Fureur du musicien qui, à la fin
de la répétition, passant devant le palais Lobkowitz, lance par
la porte un sonore « Lobkowitscher Esel… ! ».
Mais en cette fin d’été, les
nuages s’assombrissent dans le ciel de l’empire des
Habsbourg. La Troisième Coalition s’étant formée, et
Napoléon désespérant de mener à bien son projet de descente
en Angleterre, se tourne vers son plus proche adversaire,
l’Autriche, qui, de son côté, franchi le pas et pénètre
en Bavière. Mais les évènements tournent rapidement en
défaveur des Autrichiens : le 20 octobre 1805, la place
d’Ulm se rend aux Français. La route de la vallée du
Danube leur est ouverte, ils marchent droit sur Vienne.
A Vienne où, pourtant, la Première de
l’opéra de Beethoven a été fixée au 15 octobre. Il a
fallu pour cela vaincre les réticences de la Censure impériale,
qui a tout d’abord interdit l’œuvre, par une
décision du 30 septembre. Le 2 octobre, Sonnleithner avait du
écrire au Conseiller à la Cour von Stahl pour demander la
levée de cette interdiction, pour la raison que cet opéra
« a été relu soigneusement et que l’Impératrice (note : il s’agit de Marie-Thérèse de Bourbon de Naples-Sicile, cousine de François II et sa deuxième épouse) a trouvé l’original très beau, affirmant qu’aucun sujet d’opéra ne lui avait encore donné tant de plaisir ; que cet opéra, qui a été traduit en italien par le maître de chapelle Paer, a été déjà joué à Prague et à Dresde ; que Beethoven a déjà passé plus d’un an et demi à sa composition et que l’interdiction fut totalement inattendue, les répétitions ayant déjà commencées et d’autres préparatifs mis en œuvre pour donner cet opéra le jour de la fête de l’Impératrice (le 15 octobre 1805) ; que l’action se situe au XVIe siècle et qu’on ne peut y voir de rapport politique sous-entendus ; qu’enfin, il y a une telle pénurie de livrets d’opéra, et que celui-ci présente la plus paisible description de la vertu féminine et que le diable, personnalisé par le gouverneur, n’assouvit qu’une vengeance personnelle, tout comme Pedrarias envers Balboa. »
L’interdiction est finalement levée le 5 octobre, sous
réserve de quelques modifications pour les scènes les plus
dures. Il subsiste alors encore d’autres difficultés,
telles les copies destinées aux musiciens, mais les
répétitions continuent, dans la douleur : ce mois
d’octobre 1805, Beethoven écrit au chanteur Meyer (qui doit
interpréter Don Pizzaro) :
« Cher Meyer ! Je te prie
de demander à monsieur de Seyfried qu’il dirige
aujourd’hui mon opéra ; je veux moi-même,
aujourd’hui, le voir et l’entendre de loin ; ainsi
du moins ma patience ne sera pas mise autant à l’épreuve
que lorsque j’entends de si près massacrer ma musique. Je
ne puis faire autrement que de croire qu’on le fait exprès
pour moi ; je ne veux rien dire des instruments à vent,
mais….Fais biffer de mon opéra tous les pp., crec.., tous
les descrec., et tous les f. ff. ; on le les fait tout de
même pas. Je perds toute envie de jamais rien écrire encore, si
je dois l’entendre comme cela. Demain, ou
après-demain, j’irai te chercher pour déjeuner ;
aujourd’hui, je suis de nouveau mal portant.
Si on doit donner l’opéra
après-demain, il faut qu’il y en ait demain une nouvelle
répétition au foyer, sans quoi cela ira tous les jours plus
mal.»
Les jours passent, et, bientôt, il n’y a plus de
doutes : Bernadotte a atteint Salzburg le 30 octobre, les
Français se dirigent bel et bien sur Vienne, qui s’offre
sans défense à l’avance de l’ennemi. Tous ceux qui le
peuvent quittent alors la ville, les membres de la noblesse, les
banquiers, les hommes d’affaire. Parmi eux, bien sûr, les
mécènes de Beethoven et leurs amis, les seuls qui savent
apprécier la musique de Beethoven et sur les applaudissements
desquels il aurait pu compter.
Le 3 novembre, Murat, de Linz, informe
Napoléon que le désordre et la confusion augmentent dans la
capitale autrichienne. Le 7, il précise :
« Sire, le domestique du comte
de Giulay, qui a été retenu ici, a raconté ce soir, en soupant
avec les miens et en buvant un peu largement, que l’Empereur
d’Allemagne avait voulu quitter Vienne, mais que la garde
bourgeoise de cette ville s’y était opposée et le retenait
comme prisonnier dans son palais, pour le forcer à faire la
paix. Suivant lui, la consternation est `s son comble et la
plupart des riches seigneurs se seraient éloignés de la
capitale, si on ne les avaient pas empêchés de partir. »
De fait, l’Impératrice – qui pourtant, on l’a vu, a elle-même déclaré aimer le sujet de l’opéra de Beethoven – quitte la ville le 9 novembre.
Le lendemain, les troupes françaises atteignent les villages qui
ceinturent la ville. Le 13, emmenée par Murat et Lannes,
l’avant-garde française, forte de 15.000 hommes, entre dans
Vienne, s’empressant de s’emparer, par ruse, des ponts
de Tabor, seuls liens avec la rive septentrionale du Danube. Peu
après, Napoléon s’installe à Schönbrunn, Murat prend ses
quartiers dans le palais du prince Albert (l’actuel
Albertina) et le général Hulin (celui qui a présidé la
commission militaire qui a jugé le duc d’Enghien,
l’année précédente, et qui sera mêlé, bien malgré lui,
à la conspiration du général Malet, en 1812), nommé
commandant de la place, s’installe au palais Lobkowitz.
Dans une Proclamation, Napoléon tresse des louanges aux habitants et s’offre une violente tirade contre l’Angleterre. Mais l’ordre est aussi donné de faire disparaître l’aigle impérial de la première page des journaux officiels autrichiens, qui deviennent maintenant les organes de l’Empire.
A Vienne, on se recroqueville et les distractions sont
supprimées. Au grand dam, sans aucun doute, des habitants,
habitués aux spectacles. Mais cela ne va pas durer bien
longtemps, car le viennois ne peut décidemment se passer de
musique.
 Alors,
après cinq jours sans bals, sans théâtres, sans dîners, le
directeur du Theater an der Wien se met à penser que cela suffit
pour marquer la froideur nécessaire à l’envahisseur.
Alors, pourquoi ne pas offrir à ces colonels de vingt ans, à
ces généraux de vingt-cinq, un spectacle dont, il le pense, ils
se souviendront, tout autant de cette prise de Vienne, qui doit
être pour eux une date, un symbole. Sa décision est
prise : l’opéra de Beethoven aura sa Première le
mercredi 20 novembre 1805.
Alors,
après cinq jours sans bals, sans théâtres, sans dîners, le
directeur du Theater an der Wien se met à penser que cela suffit
pour marquer la froideur nécessaire à l’envahisseur.
Alors, pourquoi ne pas offrir à ces colonels de vingt ans, à
ces généraux de vingt-cinq, un spectacle dont, il le pense, ils
se souviendront, tout autant de cette prise de Vienne, qui doit
être pour eux une date, un symbole. Sa décision est
prise : l’opéra de Beethoven aura sa Première le
mercredi 20 novembre 1805.
Opéra qui a d’ailleurs changé de titre : Beethoven
aurait bien voulu garder le titre de Leonore, sans doute en
souvenir de son amie d’enfance Eleonore von Breuning,
devenue la femme de son ami Wegeler, mais le directeur du
théâtre n’en a eut cure, et l’œuvre est
annoncée sous le titre de Fidelio ou l’Amour Conjugal,
opéra en trois actes, librement adapté de la version française
par Josef Sonnleithner. Cela permettra de ne pas la confondre
avec la Leonora, ossia l’amor conjugal, de Paer, présentée
avec un certain succès par la concurrence.
Les places sont offertes au prix de 0,12 Florin, pour la 4e
Galerie, à 10 Florin pour une grande loge.
Suivons maintenant ces officiers, qui
pénètrent, en cette fin d’après-midi de novembre, dans le
théâtre, alors que Napoléon va prendre, au même moment, ses
quartiers à Brno, après avoir ordonné, de Pohrlitz, à 8
heures du matin, au maréchal Soult « de se rendre à
Austerlitz. »
Qui sont-ils ? Je n’ai pu,
malheureusement, retrouver une quelconque liste
d’invitations, voire un article mondain permettant de nous
mettre sur la piste. Mais nous savons qui se trouve alors à
Vienne, quelles troupes françaises y tiennent garnison – en
fait une infime partie de cette Grande Armée qui marche en ce
moment même en direction de la Moravie, accompagnée de
l’Empereur, qui a justement quitté Vienne, le 16 novembre,
après n’avoir couché, pour cette fois, que deux nuits à
Schönbrunn.
Parmi les spectateurs potentiels, on peut
supposer : le général Hulin, commandant la ville de Vienne, et
les officiers de son état-major, le commissaire ordonnateur
Mathieu Favier, chargé du service et de la vérification des
magasins, le général Macon, gouverneur de Schönbrunn, Daru,
nommé intendant général de l’Autriche, mais aussi les
officiers des divisions Gazan et Dupont, celles qui se sont si
durement battues, le 11 novembre précédent, à Dürnstein, et
qui sont arrivées à Vienne le 17 novembre, pour se refaire une
santé, tant elles ont été éprouvées. Mais il peut également
s’agir des officiers de l’état-major de Davout. Ce
sont là, bien sûr, des suppositions, mais qui sont basées sur
les états des troupes présentes ou transitant par Vienne durant
ces journées de fin novembre.
Ces officiers français, dont la tête est sûrement ailleurs, vont donc assister à un opéra, et d’un Allemand qui plus est, mais cela les changera des chants italiens, auxquels, s’ils ont déjà visité un théâtre en France, ils sont plus habitués. Dans la salle, on se salue, on s'interpelle, on retrouve des camarades, on se montre ses blessures. Les femmes, bien sûr, sont rares. Bref, c'est le théâtre aux armées avant la lettre.
A côté de ces militaires chamarrés, il y a tout de même des
personnalités viennoises, comme Stefan von Breuning et le prince
Carl von Lichnowsky
Le premier est l’ami d’enfance du compositeur, à
Vienne depuis 1800, où il occupe un poste de conseiller au
département de la guerre. Pour remplir la salle, il a envoyé
des billets gratuits. Demain, il fera jeter des feuilles sur
lesquelles figure une poésie sur Beethoven. Touchant mais
inutile : personne ne les ramassera.
Le second fait partie des premiers
protecteurs de Beethoven, mais aussi bailleurs de fonds, et,
comme il le rappelle dans une lettre, « son ami le plus
chaud ». Beethoven a dédié son ballet Prométhée à la
princesse Lichnowsky, dans le palais de laquelle il présentera
un grand nombre de ses nouvelles compositions.
Il y a aussi le compositeur Cherubini, le
fondateur du Conservatoire de Paris, en 1793, arrivé à Vienne
au printemps, après avoir subi la mauvaise humeur de Bonaparte,
qui trouvait que sa musique « faisait trop de bruit »
et engagé par le Théâtre Impérial, et pour qui Beethoven a de
l'admiration. Sans doute a-t-il pu entendre certaines de ses
œuvres, comme Lodosika, Les Deux Journées ou encore
Médée, que les théâtres se disputent.
Lorsqu’il sera revenu d’Austerlitz, Napoléon nommera
Cherubini directeur des concerts à Vienne et à Schönbrunn et
assistera le 15 décembre à un concert dirigé par
l’italien. Il essayera de l'entraîner en France. En vain.
La carrière de Cherubini subira alors une interruption,
jusqu’à la Restauration.
Le silence, cependant, se fait, lorsque les premières notes de
l’Ouverture se font entendre.
Cette Ouverture, c’est celle que
nous connaissons sous le titre de Leonore II, et non pas Leonore
I, car Beethoven, à peine l’avoir écrite, n’en a pas
été satisfait, tout comme ses amis. Jouée, par une petit
orchestre, chez le prince Lichnowsky, elle n’a pas été
jugée digne d’introduire l’œuvre par un auditoire
auquel ni le style, ni les idées ni le caractère n’ont
plut. Elle a donc été rejetée à l’unanimité. Et
Beethoven a, en toute hâte, en octobre et novembre, composé une
deuxième ouverture.
Notons ici que l’Ouverture Leonore
I, jamais jouée en public du vivant de Beethoven, sera
retrouvée au milieu du XIXesiècle, et introduite dans le
répertoire musical du musicien sous le n° 138.
Mais revenons à la représentation
elle-même. Celle-ci, hélas, ne va pas être ce qu'elle aurait
du être.
 Anna Milder-Hauptmann
(elle chantera devant Napoléon cinq ans plus tard, au théâtre
de Schönbrunn), qui joue Léonore, est une toute jeune artiste,
âgée de vingt ans à peine (elle était née le 13 décembre
1785, à Constantinople, où son père, autrichien, était
employé à l’ambassade d’Autriche). Élève du
célèbre Neukomm, Joseph Haydn s’est un jour adressé à
elle, lui lançant « Ma Chère enfant ! Vous avez une
voix comme une maison ! » Engagée par Schikaneder,
elle avait commencé sa carrière théâtrale le 9 avril 1802,
dans le rôle de Juno, de l’opéra de Sussmayr, Der Speigel von
Arkadien, dans lequel le compositeur avait composé, à son
intention, un air particulièrement brillant . Elle y avait
montré alors son talent, et sa voix, alors sans reproche, ce qui
l’avait conduite à être engagée par l’Opéra
National, où elle Gluck et Cherubini. Plus tard, en 1809, elle
chantera devant Napoléon au théâtre de Schönbrunn, qui lui
proposera un engagement à l’Opéra de Paris, ce
qu’elle refusera.
Anna Milder-Hauptmann
(elle chantera devant Napoléon cinq ans plus tard, au théâtre
de Schönbrunn), qui joue Léonore, est une toute jeune artiste,
âgée de vingt ans à peine (elle était née le 13 décembre
1785, à Constantinople, où son père, autrichien, était
employé à l’ambassade d’Autriche). Élève du
célèbre Neukomm, Joseph Haydn s’est un jour adressé à
elle, lui lançant « Ma Chère enfant ! Vous avez une
voix comme une maison ! » Engagée par Schikaneder,
elle avait commencé sa carrière théâtrale le 9 avril 1802,
dans le rôle de Juno, de l’opéra de Sussmayr, Der Speigel von
Arkadien, dans lequel le compositeur avait composé, à son
intention, un air particulièrement brillant . Elle y avait
montré alors son talent, et sa voix, alors sans reproche, ce qui
l’avait conduite à être engagée par l’Opéra
National, où elle Gluck et Cherubini. Plus tard, en 1809, elle
chantera devant Napoléon au théâtre de Schönbrunn, qui lui
proposera un engagement à l’Opéra de Paris, ce
qu’elle refusera.
C’est pour elle que Beethoven a conçu le rôle de Leonore.
Mais elle manque d’expérience de scène lui permettant
d’assumer parfaitement ce rôle, qui deviendra l’un des
plus difficiles du répertoire. Plus façon plus anecdotique, et
sans qu’elle y puisse quelque chose, la nature l’a
dotée d’une superbe poitrine, qui rend son apparition en
homme, surtout devant ces robustes soldats, pour le moins sujette
à caution, voire aux quolibets.
 Le rôle de Marcelline est chanté par la
ravissante Louise Müller, une chanteuse pleine de goût et
honnête, mais elle ne dispose pas d’une voix très
puissante.
Le rôle de Marcelline est chanté par la
ravissante Louise Müller, une chanteuse pleine de goût et
honnête, mais elle ne dispose pas d’une voix très
puissante.
Le ténor Fritz Demmer, natif de Cologne,
dans le rôle de Florestan, est déjà sur son déclin, il n'a
plus qu'un filet de voix, sa respiration est écourtée et il
"chante bas". Bref, sûrement plus à l’aise dans
des rôles demandant moins d’agilité vocale, il n’est
pas vraiment en mesure de se confronter à la voix d’Anna Milder
Pizzaro est échut à Friedrich Sébastian
Mayer (ou Meyer, ou Meier), attaché au théâtre depuis 1793.
C’est le beau-frère de Mozart (il avait épousé en
secondes noces Mme veuve Hoeber, soeur de Constance Weber,
première Reine de la Nuit), ce dont il se targue pour critiquer
la partition ! N’a-t-il pas jeté à la tête du
compositeur, durant les répétitions, un
définitif : Mon beau-frère n’aurait jamais
écrit de tels non-sens ! ». En réalité, c’est
plus un bon acteur qu’un bon chanteur, que le rôle
dépasse.
Jacquino est chanté par le ténor
Caché, amusant et bon acteur, mais mauvais musicien.
C’est à la basse Rothe que le rôle de Rocco est confié,
un chanteur hélas dépourvu des qualités de chanteur et
d’acteur, et dont on ne trouve, d’ailleurs, aucune
référence dans les histoires des théâtres de Vienne !
Enfin, le baryton Weinkopf prête sa voix
de basse pure et expressive au personnage de Don Fernando.
S’il échappera à la critique, son rôle n’était
toutefois pas assez important pour laisser son empreinte à la
représentation.
Voilà donc d'assez pauvres
protagonistes, face à Beethoven, qui dirige lui-même son
oeuvre. Ce n'est pas fait pour diminuer sa nervosité.
Gesticulant à l'excès, la crinière en bataille, élevant ses
bras largement au-dessus de sa tête dans les forte,
disparaissant presque sous le pupitre dans les piano, il trouble
plus les chanteurs qu'il ne les dirige vraiment.
Au début, les officiers de Napoléon,
peu mélomanes par nature, se tiennent tranquilles. Mais peu à
peu, ils s'agitent de nouveau. Cette musique ne leur fait pas
oublier les bruits des batailles, et il n'y a rien, sauf une
marche militaire et quelques appels de trompette, pour plaire à
ces jeunes gens, formés à l’idéologie révolutionnaire.
Et pour les érudits, comme il y en a dans toute armée, même
révolutionnaire, voilà trop de lyrisme, face au classicisme
dont ils ont l'habitude.
Peu à peu, le désordre s'installe, on se lève, on parle avec ses voisins. Beethoven ne les entend pas, bien sûr, mais il les devine dans son dos et il en est encore plus dérouté. Quand la dernière note s'éteint, et que rideau tombe devant une salle déjà vide, les musiciens le saluent tristement.
Fidelio sera encore joué deux fois, devant une salle de plus en
plus vide, car beaucoup de soldats et officiers ont repris le
lendemain de la Première, la route qui va les conduire à
Austerlitz, puis disparaîtra de l'affiche jusqu'à l'année
suivante.
Les critiques vont tirer à boulets
rouges sur ce premier opéra de Beethoven.
Laissons à la légende la tradition qui veut que Cherubini aurait dit ne pas avoir saisi dans quel ton l’ouverture était écrite et que Beethoven aurait mieux fait d’attendre, avant d’écrire pour l’opéra, d’étudier davantage l’art d’écrire pour les voix, et tournons-nous vers les critiques musicaux.
Ceux-ci vont reprocher à l'oeuvre ses longueurs et son manque
d'originalité: en témoignent les journaux de l'époque, qui ne
furent pas plus tendres pour l'oeuvre. Der Freimuthigem, le
journal du célèbre Kotzebue, écrit le 26
décembre (l’article parait le 4 janvier 1806):
"L’irruption des Français à Vienne a été pour
les Viennois une apparition à laquelle ils ne purent, au début,
s’habituer, et durant une semaine il régna un calme très
inhabituel ; la Cour, les fonctionnaires et la plupart des
grands propriétaires s’étaient enfuis ; les rues
étaient pour la plupart peuplées de soldats français ; la
ville était en majorité occupée par des officiers, les soldats
trouvant leurs quartiers dans les faubourgs. (…) Les
théâtres étaient également, au début, vides, puis, peu à
peu, les Français ont commencé d’y venir, et ils ont
bientôt formé la plus grande partie du public.
Dans ces derniers temps, on a donné
au théâtre peu d'ouvrages qui méritent l'attention. Un nouvel
opéra de Beethoven: Fidelio ou l'amour conjugal, n'a pas
réussi. Il a été donné un très petit nombre de fois et
devant une salle presque déserte. Du reste, la musique est bien
en dessous de ce que les amateurs et connaisseurs pouvaient
espérer. La mélodie est tourmentée et n'a pas cette expression
passionnée, ce charme frappant et irrésistible qui nous saisit
dans les ouvrages de Mozart et de Cherubini. Si la partition
renferme quelques jolies pages, c'est loin d'être une oeuvre, je
ne dis pas parfaite, mais simplement bien venue. Le livret,
traduit par Sonnleithner, raconte l’histoire d’une
délivrance, qui est devenue à la mode depuis les Deux Journées
de Cherubini "
Le correspondant viennois de la Gazette
du monde élégant, qui parait à Leipzig le 4 janvier 1806,
n’est pas moins sévère :
« Le soir je suis allé au
théâtre et là, pour la première fois, je me suis aperçu que
rien n’était comme avant. On donnait Fidelio, un nouvel
opéra de Beethoven. Le théâtre était loin d’être plein
et les applaudissements furent rares. En fait, le troisième acte
est très……, et la musique, sans effets, est pleine de
répétitions fastidieuses. Elle n'est guère faite pour donner
une grande idée que je m’étais faite, après avoir entendu
sa Cantate, du talent de Beethoven pour les compositions vocales.
Je fis remarquer à mon voisin que beaucoup de compositeurs, par
ailleurs excellents, échouent devant l’écriture d’un
opéra, et la mine de celui-ci sembla acquiescer à mon jugement.
C’était un Français, qui trouva la preuve de ce jugement
dans le fait que la composition dramatique représente le summum
de l’art de la composition, nécessitant une formation
esthétique particulière que l’on ne retrouvait pas, selon
lui, chez les musiciens allemands. Je….. et
m’éclipsais. »
Les „spécialistes“ sont à
l’unisson. Voici ce qu’écrit la Gazette générale de
la Musique, elle aussi de Leipzig :
"Ce qu'on a donné de plus
remarquable en fait de musique, dans le courant du mois passé,
c'est l'opéra tant attendu de Beethoven: Fidelio, ou l'amour
conjugal. L'ouvrage a été représenté la première fois le 20
novembre mais a été reçu très froidement...
Sa partition, lorsqu'on la juge froidement et sans
parti pris, ne se distingue ni par l'invention, ni par le style.
L'ouverture se compose d'un adagio mortellement long, qui passe
par toutes les tonalités, et d'un allégro en ut majeur; il
n'est pas plus séduisant que le reste ...... Les morceaux de
chant ne sont jamais bâtis sur une idée neuve; ils sont, en
général, d'une longueur démesurée et le texte y est répété
d'une manière fastidieuse; ils n'ont pour la plupart aucun
caractère (...) Les choeurs sont sans aucun effet; l'un d'eux,
entre autres, qui exprime la joie des prisonniers venant
librement respirer l'air, est complètement manqué. "
Laissons alors la parole à ... un voyageur anglais de 25 ans,
qui fut un temps correspondant du journal Edinburgh Review, de
passage à Vienne, Henry Reeve, qui a assisté à la deuxième
représentation, le 21 novembre et note dans son Journal:
"Jeudi 21 novembre. Je suis allé au théâtre An der
Wien voir le nouvel opéra Fidelio, musique de Beethoven.... Les
airs, les duos, les choeurs méritent tous les éloges. Les
différentes ouvertures - car il y a une ouverture pour chaque
acte - paraissent trop artificiellement travaillées pour plaire
généralement, notamment à une première audition. Complication
et difficultés, tels sont les caractères de la musique de
Beethoven et pour en comprendre et estimer les beautés, il faut
une oreille très exercée ou de fréquentes auditions d'un même
morceau. C'est le premier opéra qu'il ait composé et il fut
fortement applaudi. A la fin du spectacle, des galeries
supérieures, on lança dans la salle des exemplaires d'un poème
à la glorification de Beethoven. Mais il n'y avait que peu de
spectateurs. "
Fidelio ne sera donné que trois fois
cette année là. Puis il disparu de l’affiche.
Il va sans dire que Beethoven fut profondément affecté de cet
échec, tout en étant intimement persuadé que c’était là
le résultat d’une cabale. N’échappant pas, en cela,
à l’habitude des auteurs maltraités, il accusa le
directeur du théâtre, les interprètes, l’orchestre et ses
rivaux, bref le monde entier.
FIN