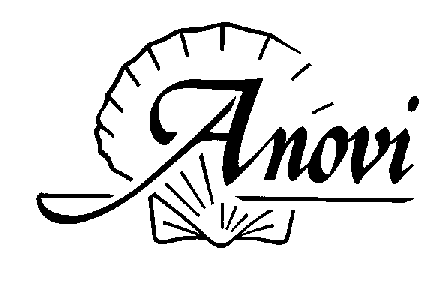
Les Acteurs
|
|
Les Acteurs |

Le maréchal Michel Ney
(1769-1815)
Duc d'Elchingen - Prince de la Moskowa
Pair de France"Le brave des braves"
Robert Ouvrard
Soldat de la Révolution
Michel Ney voit le jour le 10 janvier 1769 à Sarrelouis. Son père est ici tonnelier, qui, lorsqu'il était soldat, a participé à la de Sept ans. Ses parents le placent chez les Augustins, où il fera quelques études, suffisantes, sans doute, pour qu'en 1782 - il a treize ans - il soit employé, comme "petit-clerc", chez le notaire Maître Vallette. Il y reste deux ans, après quoi le voilà surveillant aux mines d'Appenwiller.
Ce n'est sans doute pas cette vie sédentaire qui attire le jeune Ney, car, ses 18 ans atteints, il gagne la ville de Metz et signe son engagement, comme simple soldat, dans le 5e régiment de hussards. Le voilà sous les ordres d'un certain Kellermann, une longue et brillante carrière commence.
En 1791, il est brigadier fourrier. Un an plus tard, il est adjudant et reçoit son baptême du feu à Valmy. A la suite de quoi, il est promu lieutenant. C'est la guerre contre la Première Coalition, et Michel Ney se fait remarquer, notamment à Neerwinden, le 18 mars 1793, mais aussi aux combats de Louvain, Valenciennes (25 mai - 27 juillet 1793) et Grandpré.
|
"Nous, officiers, sous-officiers et hussards, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que le citoyen Ney, promu au grade de capitaine par la voix de l'élection, a constamment depuis la Révolution donné des preuves du patriotisme le plus pur et de l'attachement le plus inviolable à la cause de la liberté". |
En 1794, il est élu (c'est alors le mode de promotion, la Révolution en ayant décidé ainsi) capitaine au 4e régiment de hussards, et il sert, à partir du 26 avril dans l'armée de Sambre et Meuse, sous les ordres du général Kléber. Ce dernier le nomme adjudant-général chef d'escadron (31 juillet 1794), et lui confie une unité de partisans, chargé de mener des attaques surprises sur les arrières de l'ennemi.. Le 15 octobre, il devient adjudant général, chef de brigade. Le 1er novembre, il est au siège de Maastricht (22 septembre - 4 novembre 1794), puis, en décembre, à celui de Mayence, où il est blessé. C'est à cette époque que, ne se jugeant pas assez méritoire, il refuse sa promotion au grade de général de brigade, proposée par Kléber.
Après deux mois de convalescence, il retourne à l'armée de Sambre et Meuse, en février 1795. On le voit faire preuve de bravoure à Altenkirchen (4 juin 1796), Friedberg (10 juillet 1796) et Dierdorf. C'est lui qui enlève les citadelles de Wurtzburg (3 septembre 1796) et Forsheim. Bientôt, il ne peut plus refuser le grade de général de brigade, décidée par le Directoire, le 1er août 1796. Il n'a que 27 ans.. Après avoir conduit la prise du fort de Rothenburg, et participé activement au passage du Rhin à Neuwied (18 avril 1797), où il est fait prisonnier.
Mais on ne reste pas longtemps prisonnier, à cette époque, grâce aux échanges qui interviennent rapidement. Libéré, il est envoyé à l'armée du Rhin, qui combat contre les troupes de la Deuxième Coalition. Avec une poignée d'hommes (150), il s'empare de Mannheim (25 janvier 1798) et, le 28 mars 1799, il reçoit son brevet de général de division.
Changement de décor : Michel Ney rejoint l'armée du Danube. Là, il sert sous les ordres du général Masséna. Mais le 27 mai 1799, il est blessé deux fois, à Winterthur, où les autrichiens sont vainqueurs, ce qui le force à quitter son commandement.
Une fois guéri, il sollicite la possibilité de retrouver l'armée du Rhin, alors sous les ordres de Moreau. La série des actions d'éclat recommence : Moeskirch (mai 1800), Höchstädt (juin 1800), Ingolstadt (juillet) et, surtout, Hohenlinden , le 3 décembre 1800.
Il a accueilli avec une certaine réserve l'arrivée au pouvoir du général Bonaparte, mais il est vrai que la politique ne l'intéresse guère. Il rencontrera le nouveau maître de la France peu après la paix de Lunéville, en 1801. Mais alors, Bonaparte, et sa famille, vont s'intéresser à lui. Tant et si bien que, le 5 août 1802, il épouse une amie d'enfance d'Hortense de Beauharnais, Aglaé-Louise Auguié, nièce de la célèbre Madame Campan, qu'Hortense a rencontrée à la pension du même nom. Elle est la deuxième fille de Pierre Auguié, administrateur général des Postes aux Lettres. La cérémonie a lieu à Grignon, propriété de la famille Auguié. Le futur duc de Rovigo est parmi les témoins.
Mais ce n'est pas tout : Bonaparte le nomme ministre plénipotentiaire auprès de la République helvétique. Ney va arriver, en octobre 1802, dans un pays où se déroule une guerre civile qui ne dit pas son nom, entre fédéralistes et unitaires. Il occupe militairement Zurich, fait prisonniers ici et là quelques insurgés, et oblige bientôt les cantons à signer l'Acte de médiation, qui place en fait la Suisse sous le protectorat de la France.
Durant son séjour en Suisse, Ney fera la connaissance d'un jeune passionné de stratégie et de science militaire, qui deviendra plus tard son ami et son aide de camp : Antoine-Henri Jomini.
L'année suivante - 1803 - Ney est envoyé commander le VIe corps d'armée, à Montreuil sur mer. Là, se forge la future grande-Armée.
Le Premier consul, en mai 1804, devient Empereur des Français et l'une de ses premières décisions d'importance est la nomination de 14 maréchaux d'empire. Michel Ney, à 35 ans, fait partie de ceux-ci. Qui mieux est : il est promu grand officier de la Légion d'honneur, chef de la 7e Cohorte. C'est le début d'une longue liste d'honneurs et de titres qui vont désormais jalonner sa carrière.
Le maréchal d'empire
L'empire doit rapidement se confronter à une nouvelle coalition des puissances contre la France. Le nouveau maréchal Ney prend la tête du VIe corps d'armée, qui, durant la campagne d'Allemagne, va, jusqu'à Ulm, se couvrir de gloire, notamment à Güntzburg (9 octobre) et Elchingen (14 octobre), où il mène personnellement l'attaque du pont et des hauteurs, en grand uniforme et la Croix à la poitrine (Macdonell). Après, la tâche sera plus ingrate, et les lauriers d'Austerlitz seront pour les autres corps d'armées de la Grande Armée. Napoléon, en effet, envoie Ney prendre possession du Tyrol - Ney parle bien sûr parfaitement l'allemand - et surtout maintenir à distance l'armée de l'archiduc Jean.. Il s'empare de Scharnitz (4 novembre 1805) et entre á Innsbruck, le 7 novembre, puis entre en Carinthie.
Ney retrouve Napoléon l'année suivante. En effet, la paix de Presbourg à peine signée, la Prusse (qui a "manqué" le rendez-vous d'Austerlitz, sans doute volontairement), signe avec la Russie et l'Angleterre la Quatrième Coalition, forçant la grande Armée "à remettre ça". Le 14 octobre 1806, Ney participe à la victoire d'Iéna, même si son impatience et son impétuosité manque de coûter la victoire à Napoléon. Lancé, comme ses autres commensaux, Murat, Bernadotte et Soult, aux trousses des prussiens en déroute, il fait capituler, le 8 novembre, la place de Magdeburg, puis, le 6 décembre, il défait encore les prussiens, à Thorn.
L'année suivante, on se bat désormais contre les Russes, en Pologne. L'arrivée, miraculeuse tout autant qu'espérée, de Ney, sauve la situation à Eylau, le 8 février 1807.
Lorsque les Russes, tenaces, reprennent l'offensive, au printemps 1807, Ney se trouve dans une position avancée, à Gutstadt, et, en l'absence de soutien, se voit obligé de retraiter, dans des conditions difficiles, manquant plusieurs fois d'être fatalement encerclé, perdant même une partie des meubles et des effets de l'état-major.
|
"le maréchal Ney avec un sang-froid et une intrépidité qui lui est particulière était en avant de ses échelons, dirigeait lui-même les plus petits détails et donnait l'exemple à son corps d'armée....." (Bulletin de la Grande armée du 17 juin). "Tu ne peux te faire une idée de l'extraordinaire courage du maréchal Ney. Nous lui devons la victoire de cette journée inoubliable" (Berthier) |
Il est donc à Friedland, le 14 juin 1807 : à la tête de l'aile droite, c'est lui qui poursuit l'armée russe jusque dans la ville, ce qui lui vaut les honneurs du Bulletin. (voir encadré)
Le 6 juin 1808, Napoléon le fait duc d'Elchingen
Cette même année, Ney est envoyé, toujours avec le VIe corps, qu'il commande depuis Boulogne, en Espagne, où Napoléon, décidé à en finir avec cette affaire espagnole, a commencé de s'embourber. Ney n'est pas seul : avec lui Soult, Lannes, Mortier, Victor sont à la tête de près de 200.000 hommes. Ney arrive à Irun, le 30 août 1808. Il va rester en Espagne trois ans, sans doute les trois plus dures années de sa carrière !
|
"Vous avez quitté la Galice où nous devions opérer ensemble sans daigner m'en prévenir et le secret de ce mouvement a été si bien gardé que je n'en ai été instruit que cinq jours après votre départ. Je n'ai point éprouvé le désastre qui m'était préparé ; j'ai sauvé toute mon artillerie, tous mes malades et les vôtres." (Lettre de Ney à Soult) |
Il réduit la place de Logrono, en octobre, puis s'empare de Soria, le 22 novembre, et d'Oviedo, en mai 1809. C'est á cette époque qu'il est placé sus les ordres du maréchal Lannes, ce qui crée, c'est le moins que l'on puisse dire, des tensions. Il n'en va guère mieux, sinon pire, lorsqu'il passe sous les ordres du maréchal Soult. Les deux hommes sont loin de s'entendre, et agissent sans se concerter, au détriment de la bonne marche des opérations (voir encadré)
En 1810, Ney, sous les ordres cette fois de Masséna, est au Portugal. C'est lui qui s'empare, le 10 juillet 1810, de Ciudad Rodrigo, puis d'Almeida, le 26 août. Mais, en face, se trouve un certain Sir Wellesley, futur duc de Wellington, formidablement retranché devant Lisbonne. Ney va mener un siége de deux mois, sans issue, car il manque d'artillerie, et on ne lui envoie pas de renforts. Lorsque la retraite est décidée, Ney commande l'arrière-garde, tâche dans laquelle il excelle, ne lâchant le terrain que pied à pied, sans abandonner ses blessés. Arrivés à la frontière espagnoles, un différent oppose les deux maréchaux, et Masséna relève son collègue de son commandement. Ney demande alors un congé, pour aller prendre les eaux (!) et rentre en France, après avoir dit adieu à son cher VIe corps, le 22 mars 1811, à Carapichina.
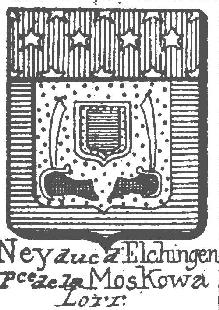 Déjà, Napoléon prépare ses troupes pour aller se
confronter à la Russie. Il charge la maréchal Ney de s'occuper de la préparation
du IIIe corps d'armée. Le 24 juin 1812, c'en est fait : les Français passent
le Niémen, à Kovno. En juillet, déjà à la poursuite des Russes qui
refusent le combat, il est à Ostrovno (25-26 juillet), à Smolensk (17-18
août 1812), où il
s'empare du plateau de Valoutina, mais reçoit une blessure au cou. Le 7
septembre, il commande le centre de l'armée á la bataille de la Moskova :
c'est une victoire qui coûte très cher ! Ney est une fois encore au tableau
d'honneur du Bulletin. Et Napoléon lui décerne le titre de prince de la
Moskova.
Déjà, Napoléon prépare ses troupes pour aller se
confronter à la Russie. Il charge la maréchal Ney de s'occuper de la préparation
du IIIe corps d'armée. Le 24 juin 1812, c'en est fait : les Français passent
le Niémen, à Kovno. En juillet, déjà à la poursuite des Russes qui
refusent le combat, il est à Ostrovno (25-26 juillet), à Smolensk (17-18
août 1812), où il
s'empare du plateau de Valoutina, mais reçoit une blessure au cou. Le 7
septembre, il commande le centre de l'armée á la bataille de la Moskova :
c'est une victoire qui coûte très cher ! Ney est une fois encore au tableau
d'honneur du Bulletin. Et Napoléon lui décerne le titre de prince de la
Moskova.
|
"Il traverse Kowno et le Niémen, toujours combattant, reculant et ne fuyant pas, marchant toujours après les autres, et pour la centième fois, depuis quarante jours et quarante nuits, sacrifiant sa vie et sa liberté pour ramener quelques Français de plus ; il sort enfin le dernier de cette fatale Russie, montrant au monde ... que pour les héros, tout tourne en gloire, même les plus grands désastres." (Comte de Ségur) |
Et puis ce sera la retraite, décidée le 13 octobre 1812. Une fois encore, le maréchal Ney aura la terrible tâche de commander l'arrière-garde. Le 17 novembre, elle va être séparée du reste de l'armée, ou plutôt de ce qui en reste, harcelée par les hourras de Cosaques. Ney réussira à lui faire rejoindre Napoléon, le 19 novembre, à Orcha, alors qu'on ne l'attendait plus. "J'aurais préféré perdre trois millions du trésor impérial, plutôt que de le perdre lui"
Du 25 au 28 novembre, c'est le terrible épisode de la Berezina. Le "fleuve" (ce n'est en fait qu'une petite rivière et quelques marais) franchi, Ney reprend le commandement de l'arrière-garde, au sein de laquelle il va faire le coup de feu, comme un simple soldat (voir encadré).
 Les épreuves ne sont pas terminées pour la France. Le 3 mars 1813, alors
qu'elle se remet à peine de la terrible campagne de Russie, et cherche à se
refaire une armée, la Prusse rejoint la Russie et l'Angleterre dans la
coalition. Ney reçoit le commandement du IIIe corps d'armée. Une nouvelle
fois, il va se comporter, avec ses hommes, de façon exemplaire. Le 2 mai
1813, à Lützen, Napoléon doit la victoire à l'énergie de son
maréchal. Ney est ensuite à Bautzen (20-21 mai 1813), et à Dresde, les 26 et 27 août.
Les épreuves ne sont pas terminées pour la France. Le 3 mars 1813, alors
qu'elle se remet à peine de la terrible campagne de Russie, et cherche à se
refaire une armée, la Prusse rejoint la Russie et l'Angleterre dans la
coalition. Ney reçoit le commandement du IIIe corps d'armée. Une nouvelle
fois, il va se comporter, avec ses hommes, de façon exemplaire. Le 2 mai
1813, à Lützen, Napoléon doit la victoire à l'énergie de son
maréchal. Ney est ensuite à Bautzen (20-21 mai 1813), et à Dresde, les 26 et 27 août.
Le vent tourne. Autriche et Suède (avec Bernadotte) rejoignent la coalition. Les défaites vont s'accumuler : à Dennewitz, le 5 septembre, pour Ney, à Leipzig, le 14 octobre, pour Napoléon. Ney est blessé au cours de cette terrible "Bataille des Nations".
Bientôt, c'est la campagne de France. Elle commence le 27 janvier 1814. Ney commande la Moyenne Garde. Il sera de tous les combats : Brienne (29 janvier), Champaubert (10 février), Montmirail (11 février), Craonne (7 mars), Laon (9 mars).
Beaucoup d'héroïsme et de bravoure en vain. Le 30 mars 1814, Paris capitule et le lendemain les Alliés entrent dans la capitale. Ney, et les autres maréchaux, Oudinot, Macdonald, Berthier, Lefebvre et Moncey, font pression sur l'Empereur pour qu'il abdique. Lorsque l'Empereur aura signé son abdication, ce seront Ney, Macdonald et Marmont qui la porteront au quartier général russe. Et c'est le prince de la Moskova qui la présentera au tsar...
Le 6 avril 1814, Napoléon quitte le pouvoir. Le 12 avril 1814, Ney est parmi les maréchaux (Berthier, Lefebvre, Macdonald, Marmont, Mortier, Brune...) et généraux qui, à la barrière de Bondy, saluent l'arrivée du comte d'Artois, frère du roi; Ney prononce même une allocution remarquée ; le 29, ils s'inclineront tous, à Compiègne, devant Louis XVIII.
Le souverain revenu ne peut se passer de l'armée pour asseoir son autorité : comme pour beaucoup, les honneurs pleuvent sur Ney :
- commandant en chef du corps royal des cuirassiers, des dragons, des chasseurs et des chevau-légers lanciers de France (ordonnance royale du 20 mai 1814
- chevalier de l'ordre de Saint Louis (1er juin 1814)
- gouverneur de la 6e division militaire à Besançon (2 juin 1814)
- pair de France (4 juin 1814)
Comme Augereau et Augereau, il entre même au Conseil de guerre. Pourtant, à la Cour du roi, ce ne sont que mépris et vexations, surtout vis-à-vis de sa femme [1]. Alors, Michel Ney séjourne de plus en plus souvent dans sa terre de Coudreaux, près de Châteaudun.
Les Cent.Jours
|
Des phrases qui font mal : "Je fais mon affaire de Bonaparte. Nous allons attaquer la bête fauve" (in in 1815. H. Houssaye) "C'est bien heureux que l'homme de l'île d'Elbe ait tenté sa folle entreprise, car ce sera le dernier acte de sa tragédie, le dénouement de la Napoléonade" (in 1815. H. Houssaye) "Je prendrai un fusil, je tirerai le premier coup, et tout le monde suivra" (de Viilepin) |
Le 6 mars 1815, Napoléon, échappé de son exil de l'île d'Elbe, débarque à Fréjus. Louis XVIII charge Ney de lui barrer la route. Reçu par le roi, il lui promet "de lui ramener Bonaparte dans une cage de fer", phrase qui lui fera tellement de tort, et qu'il contestera avoir dite sous cette forme.
Il part pour Besançon, où il arrive le 10 mars. En fait, il ne commande pas les troupes lui-même, c'est le comte d'Artois, qui remplace le duc de Berry, resté à Paris, qui assume cette responsabilité. Il a passé les troupes en revue, la veille, les troupes de Lyon, dans un silence impressionnant, puis, s'est retiré à Roanne. La situation de Ney est étrange : il ignore tout de l’immense vague populaire qui pousse les hommes à entraîner les officiers et, privé d’instructions, il cherche à entrer en contact avec le comte d'Artois. Il informe le ministre de la guerre à Paris, son collègue Soult, qu’il n’a presque pas de troupes à Besançon.
|
"Mon Cousin, mon major-général vous expédie l'ordre de marche. Je ne doute pas qu'au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon, vus aurez fait reprendre à vos troupes la cocarde tricolore. Exécutez les ordres de Bertrand et venez me rejoindre à Chalon. Je vous recevrai comme au soir de la bataille de la Moskova" (Correspondance de Napoléon Ier) |
Le 11 mars, il apprend ce qui s’est passé à Grenoble et à Lyon. Il donne l’ordre à ses troupes de se concentrer à Lons-le-Saunier et y arrive lui-même dans la nuit du 11 au 12. Le convoi d’artillerie, envoyé par Soult, est contraint de rebrousser chemin. Ney ne dispose que de 6.000 hommes, sans chevaux d'artillerie, avec à peine le nombre de cartouches réglementaires, face à ce que l'on peut désormais appeler une armée, forte de 14 000 hommes et pourvue d’artillerie.
Quoiqu'il en soit, le 13 mars Ney déclare qu'il est "en mesure de marcher sur Lyon aussitôt que je saurai d’une manière positive la direction que prendra Bonaparte". Mais il ne reçoit pas ou peu de nouvelles et, en plus, les troupes annoncées par Soult n’arrivent pas. Le soir du 13, des émissaires de Napoléon lui présentent une lettre du général Bertrand lui disant que partout la population et l’armée se déclarent contre les Bourbons, que s’il ne se décide pas, ce sera lui et lui seul qui sera responsable du sang répandu et de la guerre civile. On lui fait croire que Napoléon arrive non seulement porté par l’enthousiasme des Français mais avec l’accord des alliés, et que le Roi a quitté la capitale.
Ney balance. Peut-il
"arrêter l’eau de la mer avec les mains" ? Où est l’intérêt supérieur
de la France ? Le comte d'Artois, Macdonald, Suchet, Oudinot, tous
ont reculé devant Napoléon. Le roi le laisse sans directives. Il se
sent isolé dans une France tout entière ralliée à l'empereur. Doit-il entraîner ses hommes dans une lutte meurtrière et
inutile ? Ces hommes, le suivraient-il ? "J’ai perdu la tête"
dira-t-il lors de son procès.
Il renvoie alors les émissaires de Napoléon, sans leur donner de réponse.
Puis, il convoque ses aides de camp, les généraux Bourmont (royaliste) et
Lecourbe (républicain). Ceux-ci reconnaissent, bien malgré eux, que toute résistance est
impossible. Ney leur
fait lire la proclamation
qu’il va faire aux armées et à laquelle ils ne présentent aucune
objection. Cette proclamation est lue aux régiments, le lendemain,
provoquant un enthousiasme énorme des troupes, d'où s'élèvent les cris
de "Vive l’Empereur !"
|
Officiers, sous-officiers et soldats, La cause des Bourbons est à jamais perdue. La dynastie légitime, que la nation française a adoptée, va remonter sur le trône. C’est à l’empereur Napoléon, notre souverain, qu’il appartient de régner sur notre beau pays. Que la noblesse des Bourbons prenne le parti de s’expatrier encore ou qu’elle consente à vivre au milieu de nous, que nous importe ? La cause sacrée de la liberté et de notre indépendance ne souffrira plus de leur funeste influence. Ils ont voulu avilir notre gloire militaire, mais ils se sont trompés. Cette gloire est le fruit de trop nobles travaux pour que nous puissions jamais en perdre le souvenir. Soldats ! les temps ne sont plus où l’on gouvernait les peuples en étouffant leurs droits. La liberté triomphe enfin, et Napoléon, notre auguste Empereur, va l’affermir à jamais. Que désormais cette cause si belle soit la nôtre et celle de tous les Français ! Que tous les braves que j’ai l’honneur de commander se pénètrent de cette grande vérité ! Soldats, je vous ai souvent menés à la victoire. Maintenant, je veux vous conduire à cette phalange immortelle que l’empereur Napoléon conduit à Paris et qui y sera sous peu de jours ; et là notre espérance et notre bonheur seront à jamais réalisés. Vive l’Empereur ! |
|
« Je suis venu vous rejoindre ni par considération ni par attachement pour votre personne. Je suis votre prisonnier plutôt que votre partisan si vous continuez à gouverner tyranniquement. Jurez-moi qu’à l’avenir vous ne vous occuperez qu’à réparer les maux que vous avez causés, qu’à faire enfin le bonheur de votre peuple. Jurez-moi que vous ne prendrez plus les armes que pour défendre la patrie menacée. A ces conditions, je me rends pour préserver mon pays de la guerre civile. » |
Le 17 mars, à Auxerre, Ney est auprès de Napoléon.
Le 20 mars, le Louis XVIII quitte Paris et Napoléon y fait son entrée. Ney y arrive le 23 et reçoit mission d’inspecter les places dans les départements du Nord et de l’Est. Il se retire ensuite dans sa terre des Coudreaux.
Le 2 juin, il est nommé Pair de l'Empire.
L'empire vit ses derniers jours, les Cent-Jours.
Le 11 juin le maréchal Ney reçoit l’ordre de se rendre au quartier impérial et le 15 il reçoit le commandement effectif des 1e et 2e corps d’infanterie. Aux Quatre-Bras, sur la route de Bruxelles, les 15 et 16 juin, il livre à Wellington une bataille acharnée. Le 18 juin, à Waterloo, il charge à cinq reprises à la tête de sa cavalerie, cherchant vainement la mort sur le champ de bataille.
La fin
|
Les discussions étaient vives à la Chambre des Pairs. (...) Ney, nouvellement arrivé, ne put entendre ce rapport sans colère. Napoléon, dans ses bulletins, avait parlé du maréchal avec un mécontentement mal déguisé, et Gourgaud accusa Ney d'avoir été la principale cause de la perte de la bataille de Waterloo. Ney se leva et dit : "Ce rapport est faux, faux de tous points : Grouchy ne peut avoir sous ses ordres que vingt à vingt-cinq mille hommes tout au plus. Il n'y a plus un seul soldat de la garde à rallier : je la commandais ; je l'ai vu massacrer toute entière avant de quitter le champ de bataille. L'ennemi est à Nivelle avec quatre-vingt mille hommes ; il peut être à Paris dans six jours : vous n'avez d'autre moyen de sauver la patrie que d'ouvrir des négociations.". L'aide de camp Flahaut voulut soutenir le rapport du ministre de la guerre ; Ney répliqua avec une nouvelle véhémence : "Je le répète, vous n'avez d'autre voie de salut que la négociation. Il faut que vous rappeliez les Bourbons. Quant à moi, je me retirerai aux Etats-Unis." « A ces mots Lavallette et Carnot accablèrent le maréchal de reproches ; Ney leur répondit avec dédain : "Je ne suis pas de ces hommes pour qui leur intérêt est tout : que gagnerais-je au retour de Louis XVIII ? d'être fusillé pour crime de désertion ; mais je dois la vérité à mon pays." (Mémoires d'Outre-Tombe. Chateaubriand) |
De retour à Paris, la défaite consommée, il apprend que la Chambre des Pairs est convoquée pour le 22 juin. Il s'y rend, afin de justifier sa conduite à Waterloo. Carnot, ministre de l’intérieur, donne lecture de l’acte d’abdication. Ney prononce un discours où il dit que tout est fini et qu’il faut se soumettre. « Le seul moyen de sauver la patrie est d’ouvrir des négociations. ». Il ne se fait cependant pas d’illusions sur le sort qui lui sera réservé « Ne sais-je pas que, si Louis XVIII revient, je serai fusillé ? ».
Porteur d'un passeport que lui a procuré Fouché, Ney quitte Paris le 6 juillet 1815. Le 31 août, il arrive chez sa cousine, madame de Bessonie. Des voisins informent le préfet du Cantal de cette présence. Le 3 août, Ney est arrêté, enfermé à Aurillac jusqu'au 14 août, puis transféré à la Conciergerie, le 19 août.
Le 24 juillet, en effet, Louis XVIII, avait signé l'ordonnance, largement inspirée par Fouché, qui condamnait d'avance les personnes explicitement mentionnées :
Les généraux et officiers qui ont trahi le roi avant le 23 mars ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main armée, et ceux qui, par violence, se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétents dans leurs divisions respectives, savoir, Ney, La Bédoyère, Lallemand l'aîné, Lallemand jeune, Drouet d'Erlon, Lefebvre-Desnouettes, Ameil, Laborde, Debelle, Bertrand, Drouot, Cambronne, Lavalette, Rovigo.
Le 21 août, la maréchal Saint-Cyr, successeur de de Davout au ministère de la guerre, ordonne que Ney soit présenté devant un conseil de guerre. Afin d'impliquer le plus possible l'armée, il ordonne également que le maréchal Moncey, duc de Conegliano, le présidera, et que Masséna, Augereau et Mortier en feront partie. Moncey refuse. Saint-Cyr insiste. Moncey s'adresse directement au roi, dans une lettre pleine de dignité (dont la publication sera d'ailleurs interdite). Il est destitué par Louis XVIII, avec une condamnation de trois mois à la prison, au fort de Ham. La forteresse est commandée alors par un général prussien, lequel refuse d'accueillir un ancien maréchal français ! Moncey fera sa "prison" dans une chambre d'hôtel !
C'est le maréchal Jourdan qui est désigné à sa place. Le jury est composé d'officiers généraux. Le procès s'ouvre enfin le 10 novembre 1815, mais le conseil de guerre se déclare incompétent. Louis XVIII, alors, décide par ordonnance que c'est la chambre des pairs qui procèdera au jugement, et le procès reprend le 14, sous la présidence du chancelier Dambray. L'avocat de Ney est le célèbre Dupin, qui, quatre ans plus tard, défendra Savary. La sentence est prononcée dans la nuit du 6 au 7 décembre décembre 1815 : une écrasante majorité condamne Ney à mort : 137 pairs ont voté pour la mort (parmi eux Kellermann le père, Sérurier, Pérignon, Victor, Marmont, et 14 généraux de l'empire....), 17 se sont prononcés pour la déportation, 5 se sont abstenus; seul de Broglie a voté "non coupable"
Le maréchal Michel Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moskowa, Pair de France, est fusillé à Paris, avenue de l'Observatoire, le 7 décembre 1815. Il sera réhabilité le 7 décembre 1853, en présence du prince Napoléon et de tous les ministres.
Les lieux de mémoire

 L'exécution
du maréchal eut lieu à peu près à hauteur de l'actuel n° 43 de l'avenue de
l'Observatoire, à Paris (VIe). Non loin de là s'élève sa statue, oeuvre de
Rude, inaugurée le 7 décembre 1853 (date de sa réhabilitation)
L'exécution
du maréchal eut lieu à peu près à hauteur de l'actuel n° 43 de l'avenue de
l'Observatoire, à Paris (VIe). Non loin de là s'élève sa statue, oeuvre de
Rude, inaugurée le 7 décembre 1853 (date de sa réhabilitation)
Le maréchal Ney repose au cimetière du Père Lachaise, à Paris (29e division)
Sa maison natale existe toujours, au 13 de la Bierstrasse, à Saarlouis (Allemagne)
Le château "Les Coudreaux", propriété de Ney à partir de 1808, est situé sur la commune de Marboué, à 6 kilomètres au nord de Châteauroux, dans le département d'Eure et Loire. La famille la revendit au général Reille en 1825.
Le château de Bessonies est situé au centre du village du même nom, à environ 35 kilomètres au sud-ouest d'Aurillac, dans le département du Lot.
A Metz, place de l'Esplanade, une statue du maréchal a été érigée en 1861. Elle est l'oeuvre du sculpteur Charles Pêtre.
A Étaples (Pas-de-Calais), la maison occupée par Ney, alors qu'il était commandant du camp de Montreuil. Il avait alors son quartier-général au château de Recques, à Recques sur Course, au sud de Montreuil.
Le château de Grignon est situé á 17 km de Versailles, sur la commune de Thiverval. Pierre Auguié le vendit au général Jean-Baptiste Bessières, le 17 août 1803 et Napoléon y fit un court séjour les 20 et 21 février 1810.
Près de Lützen (Allemagne), à 25 km au sud de Leipzig, dans le village de Kaja, une petite maison abrita le quartier général de Ney.
A Vieux-Genappe (Belgique), la ferme du Chantelet abrita la quartier général du maréchal, dans la nuit du 17 au 18 juin 1815.
[1] "Ainsi, la maréchale Ney, duchesse d'Elchingen et princesse de la Moskova, redevient-elle la "petite Alguié", fille d'une ancienne femme de chambre de Marie-Antoinette, humiliée par la famille royale, moquée par la duchesse d'Angoulême" (in Les Cent-Jours - D. de Villepin)